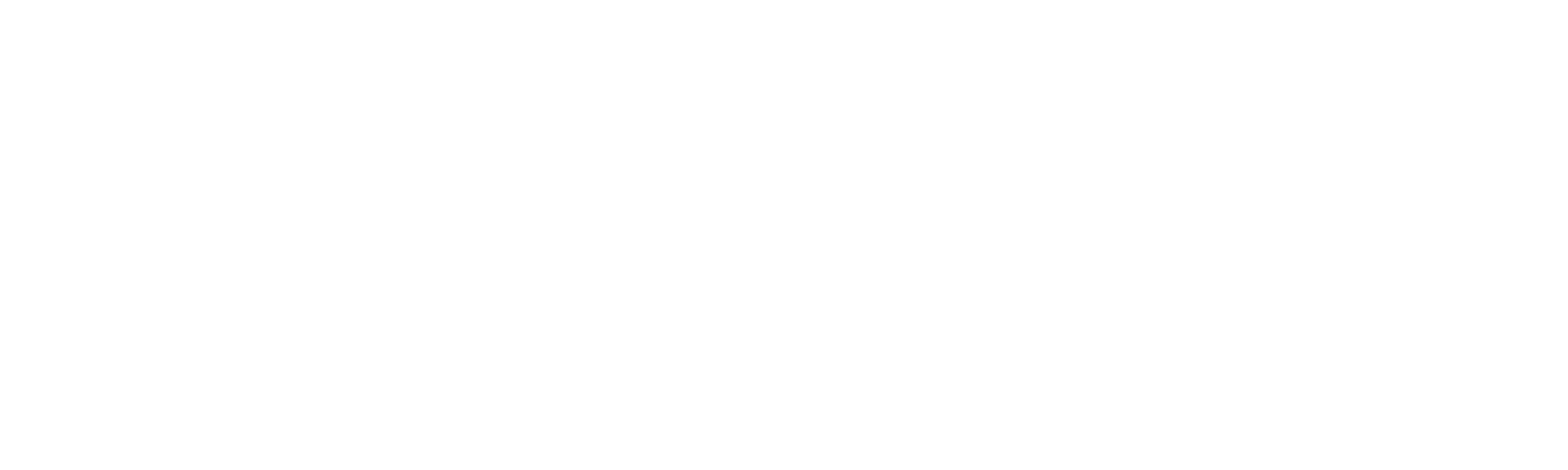Les poèmes de Paul Pépin
Un manteau banal
Le sentiment que je fais correspondre à l’inconnu :
Toujours le même; et ce qui se veut recul,
Toujours le même : un tricot de peau,
Puis une chemise, puis un pull,
Puis un manteau, puis un manteau,
Du même tissu, du même tissu.
Sur le sol je transpire et noie les champs avec le ciel.
L’horizon est une métaphysique.
Je dors dans cette pensée et pousse toute les portes,
Parce que je dors.
Un si beau nez
J’ai pris en stop ton nez pleurant,
Je l’ai mouché et déposé mourant,
Au coin du quartier,
Sans remord ni pitié.
Tu matais mon petit chapeau,
Qui te disais sous ta peau,
Fleure bien le poil !
Oh c’est si étrange un si beau rejeton,
Qu’on souhaiterait lui donner le biberon,
Mais qu’es ce que fait moi nous ?
Ils l’arrachent !
Ça ça me tâche, je lâche…
Révolue / résolue
Mon amour où hier… Mon âme où rouillèrent
Mers de lames hachées ; Merde l’a mâchée.
Maintenant là nue, l’ère révolue, main tenant l’annulaire, résolue.
Un non, sais-tu? Un nom s’est tu.
Vierge
Perles roulant doucement, elles chatouillent l’espace d’un reflet pale.
Exigeant est le caprice des vierges,
De prétendre l’absolu plutôt qu’un blanc entre deux,
Et cela fait mémoire consommée qu’elles veulent encore,
Accrocher leurs parures souillées à la porte de leurs aïeux.
L’appétit sourd au fond des eaux calmes,
De voir un jour percer et crever l’attente incessante des caresses,
En le fil d’un baiser rasant le calice froid
Où Souvenir gorge leur infini.
Mais le bouquet de toutes les candeurs est encore à rassembler.
Ailes au-dessus du front où posées sur la main,
Les poitrines se tendent retenues d’une inspiration,
Et le pas décolle, porté par un rayon.
Ivres toutes, elles s’avancent,
Pour chérir les plaies de leurs enfants morts.
Sonnet pour un devenir
Il me faut un an pour qu’une figure étrangère,
Devienne par démangeaison longue et quotidienne,
Une empreinte reconnue qui revienne sans peine ;
Confonde ses fictions et sa présence chère.
Tu n’es encore qu’un fantôme suivant mes pas,
Me chuchotant ces airs qui chatouillent à l’oreille :
«Allons par ici! Nous y trouverons des merveilles!»
Et je crois que toutes ces voix naissent de moi.
Les fardeaux du soir prennent bientôt une autre teinte :
Je broie les chimères aux formes d’éponges sales,
D’où coule le jus de ma blessure primordiale,
Dans l’attente que tu viennes étouffer ces plaintes,
En les gorgeant du sucre blanc de l’insouciance
Et des êtres épargnés de l’éphémère enfance.
Anathème aux mouches
Ce fut un beau jour d’été,
Où de son travail elle venait de rentrer,
Quand elle vit baiser deux mouches,
Sans pudeur, étendues sur sa couche.
La fureur s’empara de son cœur ;
Et transportée par ses antiques rancœurs,
Contre l’agaçante présence de cette espèce :
De l’épaisse tapette, elle se saisit en vitesse.
Les infortunés amants,
Surpris bien méchamment,
Avant le temps qu’une aile ne bouge,
Eurent en un instant, les fesses bien rouges.
Notre tortionnaire rugissante,
Infligeant punition plus puissante,
Qu’il est nécessaire à des êtres si petits,
Avait dans le regard de sombres appétits.
Sa colère à présent n’aurait de cesse,
Qu’à voir périr dans une grande messe,
Ensevelis sous une montagne de crottin,
Tous ces insectes importuns.
Ainsi étouffés par ce qu’ils aiment,
C’est le terreau prêt pour qu’on y sème,
Les rêves enfin tranquilles de notre reine,
Qui dans oreilles et nez, ne subira plus gêne.
Peinture sylvestre
Des doigts de pied épais sur la flamme lourde.
Un terreau moelleux où sont déposés les instants précieux,
Comme les histoires incomplètes dans les livres vieux.
Une lame trempée du ciel regarde
Le hibou aux sourcils gros de rancune.
L’eau sur les rochers lisses promet à l’onde voyante et froide,
De nombreux clairs de lune.
Au bord des berges comme au coin des gueules,
Déborde l’écume des festins sauvages.
La mousse est la surface du sensible
Et recouvre tout, sans politesse.
La douceur grise, mortel aplatissement par le vent,
Disperse sur les fougères pourpres, son souffle sans projet.
Morceau
I
Je ne suis pas un corps mais une présence,
Qui s’assoit dans les choses, sans demander.
Assez petite pour s’allonger dans une serrure baignée de jour orange,
Se tenir sur un pissenlit sans l’écraser,
Ou attendre dans une note sans s’y faire voir.
Quand je trouve de tels endroits : en laissant derrière moi,
Ces morceaux d’éternités qui vivent encore là-bas, je les habitais.
II
Elles sont parties les douces enveloppes qui font l’attente.
La réalité a perdu sa peau ; elle est à vif,
Et je l’écorche avec la valse de mes yeux à chaque instant.
Si elle s’épluchait encore un peu, ne resterait plus que des organes qui hurlent ;
Un tout compact au malheur d’être bien cerné, cerné sans répit !
Ici l’éternité, c’est le présent, on lui dit vainement de passer !
Ce qui rend supportable les choses c’est qu’elles passent.
La pensée du corps se fractionnant, explosant, est déjà un soulagement.
Mon bonheur est d’être morceau.
III
Mort est une lettre, celle qui nous finit et nous rassemble.
Mort est ce qui reste quand tous les morceaux sont tombés,
Ceux-là même qui la scelle en instant et la contienne :
Les sceaux et les seaux de la mort ; les morceaux.
Rencontre
Dans la rencontre de nos corps, nous faisons tomber l’enveloppe de nos différences. Si une de mes caresses dévie au contour de ton corps, de son axe qui la fait aussi tienne ; par une pression infime où tu fonds en moi, tu l’y ramène. Les plus petites choses sont ici les plus grands évènements. Un livre en une étreinte s’écrit, dans le langage des variations de pression tactiles et de souffle, sans un mot ; car le moindre signe trop appuyé, romprait instantanément la divine compréhension qui s’opère, dans le silence la contenant. De ces instants on ne garde rien, comme autrefois on a senti sans après coup, sans demander. On se ravise alors de se rassoir dans l’amour et ses banlieues saillantes, devant des regards qui retrouvent leur division organique ; ce serait manquer de respect, et se contenter de peu.
Le labyrinthe
Il marchait parmi les hommes, mais s’avança seul dans le labyrinthe. Ce dédale,vue de l’entrée, semblait infernale aux communs qui préférèrent naturellement ne pas risquer de s’y perdre. En le voyant s’éloigner, ils s’interrogeaient: « Hey lui, mais quel chemin pense-t-il emprunté comme ça ? En quoi la mélodie de ses pas sonnerait-elle plus juste ? Nos ancêtres ne se déplaçaient pas de cette manière, il marche seul, son chemin n’est pas le bon. »
Mais leur vue jouait un tour à ces intrigués, c’était un voile aux couleurs ternes et qui leur interdisait de savoir qu’ils ne voyaient là que son ombre.
Lui les voyait clairement, inertes, intrigués, lourds comme des soldats de plomb. Il voulait leur ôter ce voile qui masque bien plus que l’envol d’un homme, puis il entendit la Hauteur lui murmurer que ce rôle n’appartenait qu’à eux.
Finalement il s’en alla, il était devenu trop léger. Et en s’approchant de l’éternel, il perdit ses yeux, et l’illusion du temps s’en alla avec eux. Il savait maintenant que la lourdeur n’était qu’éphémère, qu’il ne restait plus rien à vivre et qu’il restait encore tout à vivre.
Départ
Depuis petit, le monde est chiffre, et dans ses images, et dans son explication. La lune était temps de révolution et quartiers dénombrables ; les animaux disparus un bestiaire fantastique fait de dates et de noms savants. Je vivais là-bas, devant ces autels invisibles où j’étalais mon sang. C’est ce que m’avaient offert les livres à quatre ans. À quatre ans on ne comprend que ça, et j’ai trop compris. J’ouvris un jour les yeux sur mes pieds, morceaux sans vie ; leurs profondeurs remplacées par un chiffre, que pendant longtemps j’ai gratté. Je n’ai pu trouver l’indéfini qu’en moi, et l’ai plaqué sur les choses ; ou bien j’ai mélangé les choses en moi, pour leur souvenir leurs couleurs, et tromper les limites de mon expérience. « Ou bien » est le « je ne sais pas » libérateur qui fait fondre les lignes. La ligne est là où notre horizon s’arrête ; l’horizon l’incarne par excellence. Après elle vient la pliure où nous sommes fini ; moulé géométriquement.
Tous les dieux sont de nouveau possibles ; c’est-à-dire : il n’y en a plus. On ne peut pas dire qu’on retrouve l’originel ; plutôt le mot sans les mots, sans cette mathématique organisatrice des mots, ces morts sots, qui sont à vous ; lourds et faciles à contempler dans leurs cadavres calmes. Regardez ce qui peut, couler depuis la tête, sans parvenir au cœur :
Les épais nuages sont un rideau tiré sur le milieu de l’horizon marin, par les derniers halos orange du jour qui dorment aussi, entre les vagues noires au destin d’écume.
C’est à vous ; pensez-le ; et relâchez vos vaisseaux !
Le fameux soir
I
Pendant là
Nos gorges étranglées par le silence,
Déployées dans les tunnels de feuilles,
Font tel de grands vases de faïence,
De postillons d’astres le recueil.
Ensuite
Mon corps laissé froid sur le sentier,
Sous la peau noire de ses yeux immenses,
Par demain venant déjà reniés,
Porte au cœur l’impossible assonance.
Jeu constant
Je n’ai jamais accordé de sens à ce que je dis sinon à mon narcissisme encadrant rien, trouvant son final et parfait plaisir dans l’aveu de mon impuissance. Je me suis assez rêvé ; langue pompeuse qui n’a rien à dire. Ma seule manière de vivre à présent est de faire vivre l’enfant agonisant, par un simulacre conscient qui agite ses branches pourries, et laisse tomber quelques morceaux d’un éclat passé. Par là je retrouve un semblant de cette douce neutralité originelle qui se sent partout chez elle. On ne peut être honnête avec soit même que de la sorte. Elle est passée la roche écrasante, qui atteint sa plus haute contrainte où pour l’indifférence, on est plus assez naïf, ni encore assez soufrant. Je veux lui cracher à la gueule que je l’aime, ne faire que l’aimer en lui crachant dessus. C’est le terreau et le tombeau des pensées pures ; elles ne rebondissent dessus qu’à moitié. Je suis corrompu. Je ne peux pas vous dire si je suis le grand séducteur ; méfiez-vous.
Le mec qui craque
La race humaine est une irrémédiable baiseuse, elle a inventé la civilisation pour ne pas crouler sous sa descendance en tant que déchet. Chaque mot cache sa profonde envie de forniquer, un mur. Laissons-nous aller à la grande orgie à laquelle nous aspirons tous, et en musique s’il vous plait monsieur le curé, vous qui savez si bien ce qu’est la contrition et son abolition par la pulsion détournée et par le fouet ! Je vous envie, tant de spiritualité et un sexe si profond qui coule sous une soutane blindée noire impénétrable. Ça doit être une si grande satisfaction de faire tenir une parabole sur son zob, sans aucune objection. J’en suis réduit moi volontairement, à me justifier l’acceptation de ma contenance par un penchant du gout, et quel mauvais gout, je tiens à quoi au fond ?
Sapristi quelles foutaises mon seigneur ! La banalité est si facile à contourner et c’est si banal. On en est rendu à s’allumer une clope sur un balcon et à ne penser a rien ; l’époque est aux choses les plus raffinées sans penser à rien et advienne que pourra. Quelques soufflets de narines amusés et forcés veulent à toute force y trouver quelque chose à ce raffinement du rien, parce qu’ils ne veulent pas y trouver ailleurs et l’ailleurs a toujours été ennuyeux. C’est immonde et il faut arrêter, décaler le discours à des limites : celles de notre propre qualité à nous confondre dans le collage de valeurs positives sur tout ce qui est un minimum neuf. C’est une décadence tout à fait consciente. Que devrais-je faire ? Me tuer surement, parce que je ne peux assumer naïvement la civilisation ni aller contre.
Dans l’avenir, on ne parlera plus, on ne fera que s’écrire ; et l’individu sera accompli. Quelqu’un s’adresserait à nous, que nous irions nous enterrer dans l’humus d’une forêt en nous remplissant les oreilles de colle. Tous les regards seront les regards du monde total, les autres seront bouchés par du verre brisé. Nous serons l’ouverture autour de laquelle se déversera et s’effritera l’eau de raison du ravin rond, tout l’océan sans exception. Nous recouvrira un symbole unique auquel tout le reste se subordonnera. La psychologie n’est pas une représentation de la réalité, c’est une prophétie.
Ces marques qui tortionnent notre veille et l’amène de biais, par derrière, à la même chose mais avec un tour de plus, il faut vivre pour ça. Avant aussi on vit bien dans le chaud réconfort des proches, encastré en eux et aussi passif qu’un poil, qui sent juste passer le réel sur lui indifféremment, tout en étant la somme infinie de ses vibrations.
La valse
La valse des cheveux bruns,
Éclabousse les visages, d’un frôlement malin.
Au dehors le ciel dévore les cheveux cuit et les feuilles calcinées.
Il tombe des tombeaux dans les gueules grandes ouvertes,
Et je dis à ma mère de ramasser ses fleurs dans la cave, teintée beaucoup et varié.
Le coin du monde se soulève sous la pluie qui le détrempe pour montrer
Son mouvement suivant où il y a un fauteuil,
L’attente pure, et son regard qui se trouble en deux sur nulle part.
Ma main, elle, sait toujours quoi faire.
Elle fait la belle et prend des poses pour plaire au mur blanc
Paré de jolies punaises mais quand même.
Je la punis de sa vanité en l’envoyant dans mon nez ;
Elle doit bientôt me servir à être musicien.
La valse des cheveux bruns, se déposa finalement, au flan de ma main.
Part à l’aventure après ça, et ne reviens jamais !
Un beau suicide vaux mieux que les chatouilles de dieu sur un ventre endormi.
Ne t’accroche pas à ses cheveux parfumés qui te disent :
« Tiens moi, et dépose moi encore sur le flottement de l’air ».
La valse des cheveux bruns, on la regardera bien encore jusque demain.
…
Laissons cette humeur factice aujourd’hui, nous avons à faire des buissons de temps, ceux que l’on regardait, on se retournait, on y était, c’était fini on gobait les baies du levant. On tirait sur le toit du toit de la nuit, toit des toits, et alors les feux crépitaient plus fort dans l’oreille en murmure. Le confinement qui ronfle autour émousse. Cours ! Les chevaux nous rattrape avec leurs ombrelles cubistes, les chevelures fondent dans la nuit allant et venant d’un seul trait, je rends la beauté au creux du pinceau, pas le mien, celui qui m’a donné. Je me suis déjà perdu à chercher je ne referais plus l’erreur, alors que tombe ma gravité au fond de mes chaussettes et me colle à tout ce qui veux bien tamponner l’éponge desséchée qui roule au sentier aride. Le soleil s’est levé sans s’en rendre compte, il est quelle heure ? Il est temps de s’assoir et de prendre sa ration quotidienne, d’oublier le ciel de lierre et de plonger dans la terre liquide. Si tout est liquide, je suis juste trop dur ? Dis-moi que tu voudras bien de ma matière ? Je ne supporterais plus rien sinon. Tout est possible si tout peux se fondre, et les énigmes sont de se croire morceau qui n’a pas trouvé à s’emboiter parce qu’au fond il ne s’emboite pas. Carillonnons aux fenêtres ouvertes pour aérer d’un souffle les draps d’embaumement, tout résonne clair et pur à présent, au fond du bois où nous n’irons pas, en remontant la petite rue pavé qui n’existe plus, dans le lien du désert qui déroule au glacier qui glisse. La parade est en marche et les bras dansent avec le plomb au milieu du taillis moyen. Allons dormons encore, tout y coule et tout est ensemble.
Les choses sont si là
Les choses sont si là.
Si la mi ?
Si l’ami là, les choses…
Non.
Si je les aime, c’est que personne n’y a rien mit.
La seule altération que je me permets c’est m’y imaginer de loin.
Mon nez est tellement puissant que quand je renifle… non.
Ah ! Mes doigts sont tellement longs que je peux me gratter la tête sans lever les bras.
On ne peut atteindre qu’avec ce qu’on imagine, mais atteindre quoi ?
Le fond des choses, je pourrais en faire une décharge puis ensuite le regard plein d’une femme.
C’est encore se donner trop d’être que d’en changer.
Je veux porter toute les contradictions du monde.
Je serais insoutenable.
Il y a un point ou on ne sait plus si c’est drôle ou pas, parce qu’en face non plus on ne le sait plus, parce que quelque chose nous a rattrapé et on ne peut ressentir trop de choses à la fois. On arrive au bord d’un ravin et rien ne va au-delà.
Ce sentiment d’avoir enfin attrapé par-delà, ça se retourne contre soit. Au bord du ravin on ne voit pas d’horizon, on ne voit que son propre visage écrasé.
Et je l’écraserais jusqu’à ce que je ressemble à quelques choses !
Est-ce que j’ai raison ?
Dieu ne peut pas être, parce qu’il serait obligé de donner tort à quelqu’un.
Je ne SAIS pas ce que je dis.
Ce qui ne sait pas ne peut pas être.
Attente
Asseyons-nous loin de la scène,
Camouflé dans la noire laine.
Écoutons les discours qui errent,
En murmure au-dessous des pierres,
Et si un instant, clairsemé,
Sous l’appel de l’autre je flanche,
J’éteindrai ma voix enflammée,
Dans le silence creux de tes hanches.
Tu es
Si je pouvais dire sans lourdeur ce que.
Jaillirait de ma.
Le blancs de.
Drapant le trou sans voix.
Tu es.
Et le lointain.
Où tu m’a vu une fois.
L’effet de ce qui sort du cœur
N’est pas plus qu’un remous sur le ventre.
Un point prématuré.
Qui fixe à jamais ton sourire.
Le blanc de ton sourire.
Il m’attend toujours.
Il est probable qu’on ne dise rien avec un point.
La goutte qui brilla mille fois
Jamais plus loin que la commissure de mes lèvres.
Si ce n’est que je.
Séparer c’est perdre
On a ouvert un gouffre en décidant de se mettre à parler, il faut le remplir maintenant. J’y ai mis une forêt déjà : nos pensées. Il sera rebouché quand l’intérieur sera le miroir de l’extérieur. Pourquoi nous serions nous mis à décrire nos pensées avec les mots qui décrivent la nature à moins qu’elle ne soit une forêt, avec ses arbres, sa terre et son ciel. Toutes ses variations se retrouvent dans la nature, on l’a oublié avec le temps, et séparé la pensée de l’extérieur. J’utilise deux mots qui au fond ne doivent pas être distincts, mais ils le sont pour l’instant. Certainement ils se sont dissociés le jour où l’on a cru que l’un était plus que l’autre. Mais qu’est ce qui nous sépare sinon l’air et nos corps ? Pas une essence différente, ça n’existe pas, je ne sais même pas ce que ça veut dire à part quelque chose qui n’existe pas. On a cru à l’invisible, on a cru que l’espace laissé par le gouffre avait une existence propre, c’est de là que vient en même temps l’origine de la nécessité de le combler. D’où la question : le gouffre s’est-il ouvert parce que nous commencions à voir ce qui n’existe pas? Ou bien est-ce parce qu’il s’est ouvert que nous avons commencé à voir ce qui n’existe pas ? Les choses qui n’existent pas ça ne comble rien, on ne peut pas se rencontrer sur une particule ou sur la bedaine de dieu. Dans un champ on peut, et on se dira, je suis là au milieu du champ, et en face on répondra moi aussi et on aura plus besoin de parler. Parler restera un loisir fantaisiste consistant à imaginer ce qui est possible si on est. On parlera toujours, mais en ayant pleinement conscience de ce que c’est que parler. On ne sera ni seul ni ensemble car tout ce qui peut dire cela est un artifice, on sera juste quelque chose qu’on ne peut pas dire, c’est-à-dire ce que nous sommes déjà et que nous ne disons pas, mais ce n’est pas de l’être, je ne peux pas parler pour le dire, ça voudrais dire qu’on se rejoint sinon, et ma fantaisie consciente à moi est de m’imaginer croyant que je peux le toucher du doigt. Tout ça est très vrai ou très faux, ça dépend si on se place ou non. Il faut sans cesse réapprendre à se mentir mieux pour conserver le statut de réalité de l’apparence, ce n’est pas un choix, c’est le point où l’on est le plus lucide, sans pour autant empêcher la nécessité d’être des choses pour nous.
Désordre
Tourne en rond autour de ce qui ne t’engage jamais, mais l’écriture te rattrape à n’être qu’en décalage. Fleuri, en ton centre, en pure fiction, et plante-toi dehors. Je vois et ça suffit, mes mains sur la surface rugueuse des troncs et des murs pensent à ma place. C’est ainsi que je peux me lever sans masse, sans mettre d’unité en action. L’énigme des formes est un moteur à se cogner, tout devient transparent et sensible, je est en vide et place de l’air, cette caresse apaisante où transpire l’encre, cette transpiration qui n’a rien à voir avec l’irrégularité dérangeante du corps. Elle est le recouvrement par l’action sans effort où se loger et attendre tout en se donnant l’illusion d’avancer. On me voit avancer mais c’est une projection. Si on me voyait, je suis toujours au même endroit, celui où je tombe avant d’exister. J’aimerais dire bonjour, mais ce n’est jamais ce qui sort de ma bouche, il sort « c’est d’accord, mais je ne suis pas là ». Le désordre est brillant, éblouissant, la question est de s’y complaire ou non.
Découverte musique classique
Beethoven : Symphonie n°7 – 2ème mouvement
http://www.youtube.com/watch?v=mgHxmAsINDk
Pachelbel : Canon
http://www.youtube.com/watch?v=stCKjZniMsQ
Haendel : Sarabande
http://www.youtube.com/watch?v=klPZIGQcrHA
Prokofiev : Roméo et Juliette – dance of the knights
http://www.youtube.com/watch?v=hUj-2aCOHSQ
Saint-Saëns : Concerto pour violon n°2 – 2ème mouvement
https://www.youtube.com/watch?v=AizF8tKtuak
Wagner : Tristan et Iseult – Prélude
http://www.youtube.com/watch?v=-maRqSrhfAk
Chopin : Fantasie n°49
https://www.youtube.com/watch?v=C-gbgLo1Y74
Tchaikovsky : Concerto pour violon n°1 – 1er mouvement
http://www.youtube.com/watch?v=KOTQN0tNNNY
Debussy : Clair de lune
http://www.youtube.com/watch?v=ufNZNOHtQ3o
Brahms : Danse hongroise n°5
http://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
Paganini : Concerto pour violon n°5 – 3ème mouvement
http://www.youtube.com/watch?v=eTgFGsGaUeQ
Schubert : Sonate pour piano D. 959 – 2ème mouvement
http://www.youtube.com/watch?v=Il6-lZYDpqY
Arvo Pärt : Fur Alina
http://www.youtube.com/watch?v=8as_BN5h5YQ
Dvorak : Requiem aeternam
https://www.youtube.com/watch?v=3eN5EUMXBQo
Fauré : Requiem – Agnus Dei
https://www.youtube.com/watch?v=iMlr4XKNcNo
Bach : Variations Goldberg – Aria
https://www.youtube.com/watch?v=rCuALWK6ZNg
Pettersson : Symphonie n°7
https://www.youtube.com/watch?v=UxQyUzOXPiY
L’anti-intelligence
Ô furieux rusé, reconnaître l’amertume de ton miel se nomme douceur et se nomme joie!
Puisque les visages de la beauté sont innombrables, et puisque dire ses noms n’a pas de fin, tu choisiras toujours bien ton vêtement.
Ô sournois sinueux, on ne connait ta pauvreté que lorsqu’on est riche.
Tu sais rester caché dans l’ombre du sommet des cœurs dignes, pathétique serpent, car tu y suffoquerais.
Mais toi, qui est plus enragé que mille déments et plus repoussant que tous les rois des abjects,
est-ce vraiment ton choix ?
Peinture vivante
Quand on finit d’être un homme et que l’esprit devient blanc, se présente à lui la peinture de la vie. Il voit que les animaux sont verts mais que les hommes ont la peau bleue! Puis en regardant mieux, il en remarque quelques-uns qui sont tout rouges.
Dans ce tableau, un fossé sépare les bleus des rouges, pas très large mais dont personne ne voit le fond. Les bleus ont construit quelques ponts et les empruntent de temps en temps, mais ne restent jamais longtemps chez leurs voisins. Ils ne s’aiment pas beaucoup, même si ce n’est qu’entre bleus qu’on se fait la guerre. Les plus rares n’ont pas de pieds et traînent leur ombre dans un brouillard épais au-dessus du fossé. Ce sont les plus seuls et ils sont gris. Là où ils sont personne ne peut les voir, et ils sont aveugles, sourds et muets. Certains peuvent jaunir leur teint par la force, mais jamais n’obtiennent l’éclat du début ni celui de la fin, seuls quelques magiciens connaissent la blancheur essentielle.
En contemplant l’œuvre, l’œil enfin réalise qu’il est aussi la main et qu’il est le dialogue. Quand on finit d’être un homme, on est
.
Cinq pichenettes semblables
Le caractère impérieux éclate en poudre aux yeux, sur les syllabes impeccables où la moue se veut.
L’apostrophe étranglante remet au niveau de la spirituelle décharge, sans interrompre le semblant mathématique qui dirige l’organe soucieux.
L’escalade en pratique de feu, est l’incartade où l’ennui fuit les cieux.
Il faut trébucher pour trouver où l’on est avant d’exister, car le frisson s’étale où l’œil est nuit.
La velléité passionnelle s’éteint en éruption sur elle-même, et entame la matière à creuser dans le corps de la langue.
Naître c’est n’être
Lorsque la pensée s’éteint, que la vague du rêve s’émousse doucement au bord de la réalité, une seconde dure cent ans. À cet instant l’un se détend, et la division s’efface comme à l’orée d’une flamme dorée.
L’or est présent pour le zélé aux pieds ailés, mais n’est qu’un songe pour l’œil rêveur. Si près des cieux, cet or précieux enseigne à l’individu qu’il est un divisé, et que l’individualité est une illusion.
Une vérité devient mensonge dans la pensée, c’est dans la neutralité d’une spirale infinie que réside le cœur de son élan. De même qu’au-delà du cyclone destructeur se trouve le calme, de même que le chaos dissimule l’ordre, derrière le flux de la pensée se cache l’impensable.
Peinture anachronique
Sous la pluie fine qui coule entre les ardoises,
S’achevait le croquis, d’un buveur de cervoise.
Descend dans les égouts, la ville ombilicale ;
Le vestige spectral du vert sol clérical.
Les senteurs varient, de la pierre à l’urine,
Et les plaies disparaissent, aux fenêtres azurines.
Prochainement la langueur sera congénitale,
Dit le marquis flânant, sous sa coiffe digitale.
Le sang sec oublié sur les draps de flanelle,
Traînera derrière lui, ses notes solennelles :
« Oisicalurine italanelle »
Le vent
Quand l’on se tait vraiment
Il y a l’homme caché en tous lieux,
C’est son vœu de ne laisser rien,
Il prend même le vent par la main,
Lui glissant sans fin ses mots pieux.
%%fichier:521:droite:moyen%%
Je veux perdre et te laisser perdre,
Car plus beau que de s’y loger,
En ton dehors aménagé,
C’est de contempler le désordre.
On ne mettra surtout rien entre,
Et les regards retrouveront,
La pureté sans démarche des fronts :
Une forêt où les arbres s’effleurent.
Courte fuite
Je suis au vent
Et la mémoire me porte
Autour des tours de pourcent
Je glisse sur la qualité sortie
A jamais nous sommes différent
J’ai aimé des bâtons tordus
Tu n’as pas su voir
Et si on te chatouille
Tu retrouves vite ta raison
Elle me voit
Car toujours elle me précède
Accrochée dans mon dos
Elle est trois fins croissants de lune
Et c’est pourtant la gaieté
On lui grogne qu’elle n’a rien à faire là
On se reprend la seconde d’après
Mais trop tard elle s’est rendormie
Du regard le plus tendre et mort
Et l’on regrette ça toute sa vie
Elle est aussi un pot de fleur
Aussi une femme quand elle s’ennuie
Elle n’est plus que terre
Mais je suis au vent
Et les graines tombent au hasard
Elle entend mes échos d’enfants
Et j’ai beau me faire un corps de foret
Qu’elle sait où je passe
Car je suis au vent
Un souffle qui veut qu’on l’entende
Elle n’est plus dupe
Et les grandes cités n’ont jamais été son souci
Elle est à la terre et je suis au vent
On ne se porte qu’aux tempêtes
Je me tais
…
Elle frémit
Elle se réveille
Me sourit
Nous partons chercher du travail.
Fin du soir
Je pourrais un jour te donner des mains,
Pour y déposer de la viande et de l’encre,
Et ce sera la fin que j’ai voulue.
La caresse du vent
Sur mon visage
Me comble.
Morceaux aux liens lointains
Notre distance est une veine saillante, déterrée à l’horizon quelque part, où circule notre compréhension.
Il y a quelques chose de remarquable dans les villes à laquelle on ne pense pas, c’est combien tous les éléments qui la compose ont à un moment donné été entourés de petites mains délicates ou de grosses mains rudes qui les ont ordonnées.
On se laisse peut être penser certaine idioties pour pouvoir ensuite être dur avec soi.
Ce que je souhaite que l’on reconnaisse de moi, c’est l’ampleur de ce qui s’y est construit de parl’ons, cela je veux que l’on l’aime, tout du l’ong.
J’imagine un corps où dans un espace inconscient il y’aurait la possibilité de refaire sa vie à l’infini, sous la croute éternelle et figée de ce qui se présente au monde.
Un homme devient beau lorsqu’il n’adresse plus sa perte qu’à personne.
Peut-être qu’à force de se regarder vivre cette vision se confondra avec la vie.
Cela m’étonne toujours quand tu me trouve au lointain de métonymies atones.
Même quand je ne calcule rien je pense vaguement que je ne calcule rien et j’en visualise les conséquences.
Je me réveillais et en remontant dans mes pensées je me suis cogné la tête.
J’expirais à l’unisson du chant des oiseaux et leur extirpait le souffle.
Cancrelifla passetaboum
Cancrelifla passetaboum : cœur haut percé fil à terre et les maths et les bonheurs. Temps chaîne à la production musicale où la clé volée de madame tête de mort enlève le AH! Écouter la flèche à pique dans l’espace anguleux qui dépasse; ennui gerbe le béton au fauteuil vide. Papy bois s’égosille le clapet pour tousser l’herbe à pluie toc! Aspiration des flammes étourdies, par l’écrit d’obédience, container parre terre où se concasse éclairs.
///PAS
PAS -> s’il -> vers -> jardin mélancolique
pas de mouche -> calciné -> lune déracinée
trou nuage = globe étrange
paradis ÷ bonheur
inconnu = tout sauf Ø
bannière de maillle -> homogène inssuportable -> Ø aux cieux
Salade sacrée
Un orgue monte en piété et la salade du jardin épouse ses contours. on voyait non loin des charrettes légères, l’armure qui a fini de rouiller. Et les renards en ronde, passent dans les sous bois. Les temps ne changent pas entre les tintement régulier de métal. Une peinture est méditée jusqu’à l’absence, dans la grâce d’une main tendue.
Statisme
Si je trahi mon ombre, aux yeux des multiples reflets humains qui m’absorbent, je suis fini ; et j’ai peur que glisse dans des vases étrangers le contenu du désir de m’être assoupi en toute chose.
Ce sont les arbres de mon jardin qui m’en préviennent, menacés toujours par les haches du devenir ; et j’écoute encore leurs envoûtements ; un arbre ne peut pas être mauvais n’est-ce pas ?
Je devrais être sur la route uniquement, et ne plus mettre rien dans un endroit.
Le jour
Le jour est con d’être tellement sûr,
Alors mieux vaut s’écarter sans bruit.
Balance une grimace contre un mur,
Le ridicule vaut mieux que l’ennui.
Et je cramerais nos coquilles vides,
Que la vie se souvienne sa couleur.
Nous plissons déjà trop nos rides,
A présent c’est vrai vient notre heure.
Je veux emmener le monde dans la mort de sa trace.
Les pis du paradis m’ont gorgés,
J’ai oublié, l’azur tourne avec mon œil.
Des armées possédées rient devant moi,
M’enfonçant leur canon dans les nerfs.
Il faut faire la guerre ailleurs.
On pourrait tenter dans l’âtre ;
Où le feu couve,
Où l’esprit se mangerait jusqu’au vide;
Qu’un petit père de papier se dressent fièrement,
Derrière les derniers rayons des astres;
Et que les amoureux laissent tomber la durée,
De leurs sacs de moelle.
Mais les enfants piaillent encore derrière les bars;
Aux tambouilles infâmes la paresse est reine.
J’ai laissé partir ma petite pierre triste dans mon os;
Sans protester, rien, comme si c’était simple,
De se projeter sans arrêt une enveloppe d’éventail,
Battre l’air un coup et se replier.
Le printemps a rompu les épousailles humides des cimes et du ciel,
Il reste à chevaucher la rumeur qui monte par l’étamine.
Je m’étais perdu un instant;
Quand le dehors tombe, qui expire,
Sous la chape des branches,
Que le soleil au sol allonge.
Églogue
Entre les chaudes averses,
On tourne le pied des girolles de juillet.
Des animaux jamais vus laissent de vastes cercles
Parmi les colonnes de chardons.
Plus bas, un étang noir,
Couvert par la rumeur des mouches ;
Encerclé par le silence des papillons
Nageant à la surface des herbes fauves.
Les glumelles effleurent le haut des cuisses
De leurs têtes qui s’entrechoquent,
Et chuchotent une fois au loin
Des allées vagues ainsi frayées.
Souffle
Ne suivons pas les indications d’un étendard aveugle,
Perte des hirondelles farouches aux angles cachés des taillis.
N’oublions pas qu’elle s’installe,
La musique facile des doigts de pied
Qui grincent en chœur devant la pression constante des os.
La mer finit par avoir peur, son chant se fait timide
Et perd l’indélébile façon d’arrêter la pensée
Par un arrosage patient de métaux brillants.
Le sentiment qui prend part toujours
Est celui de la structure qui bâtit,
Et qui empêche de dire.
Je suis plié dans le marais
Et n’entend que le gribouillis lointain des clochers.
Le bois monte autour et s’arrête vite en crête où rien ne s’imagine.
Comment fumer sans se vider
Comme une baudruche de peau le long d’un triangle ?
Une révolution les mains plongées dans la terre
Et non l’azur aussi débile que l’addition.
Leur machine est cassée,
Il n’en sort plus que des diables aux fesses roses
Adorateurs de lettres jolies, sans brûlures ni morsures.
La luciole immobile dans le talus de mon corps,
J’ai retrouvé mon hasard !
Mon vieil idéal est enfin des épaves de nuages
Coulant dans le bain d’automne.
Clochers vous tintez de travers depuis quand ?
Maintenant vidée ma terre,
Je remonte où la solitude entend battre le sang.
Rires sans fondements,
Vous êtes l’orient de mon souffle.
La peur
La peur mouille le sol moucheté ; une ficelle blanche de plastique destinée à fermer les poubelles traine et prend diverses formes, soulevée par le souffle des pieds passants. C’est fiblampla de fermepoube ; jamais lui trouvera-t-on un nom plus noble ?
La peur est toujours sous la lumière, puis sous fiblampla, puis sous le sol moucheté, puis sous l’ombre, puis sous moi.
On peut enlever quelque chose aux passants avec un crayon, ils ont raison de me regarder avec inquiétude, un regard un instant pour un mot mauvais dans l’intime.
Il pleut des marques au hasard du vent qui permettent de penser, dans leurs impacts sonores. Il faut leur demander ce qu’elles ont à dire, elles sont toujours très bavardes et ont beaucoup d’amies qui s’éveillent en les entendant, jusqu’à couvrir le corps de vibrations si on oublie l’oreille sélective. Elles peuvent aussi chanter et crier en chœur FOR-
niquer ! (le cœur parle)
é ! ( é quoi ? l’air ?)
êt ! (le manteau de la solitude)
fait ! (encore à faire)
ge ! (il se réclame, il s’affirme, il est bien là)
cément ! (oui, ça arrive, c’est du solide)
te ! (ça ne se dit pas)
MORCEAUX
Recueil de poème de Paul Pépin
Paysans
L’air s’engouffre dans la petite voiture
Et ordonne au désordre immobile de s’asseoir.
Tout est pressé sans qu’il n’en sorte aucune larme;
Seul un espace blanc, naît au-dessus des fronts.
Et les paysans chétifs
Parcourus des poisons qui les mélangent
Rentrent chez eux
Égarés aux yeux de leur idéal avenir.
Masque
Madame la punaise fait le tour du pare soleil,
Peut-être en quête pour ses enfants,
Et bien que ne se révèle rien d’intéressant,
Pour un tour de plus appareille.
Les détonations musicales sont pour elle
Les détours d’un arbre sinueux,
Les traces dans la boue d’un animal gracieux,
Cumul de variations sans séquelles.
\- Pour les oreilles de chaire,
A l’instant imprégné des rythmes charmants,
Cela promet de beaux restes surannés quand
La portière s’ouvrira sur les décors primaires;
Angle serré sur les buissons vides
Où l’harmonie se repose.
Un seul pas tendu s’expose
Qu’il montre ses affreuses rides.
Ô le maudit visage!
Indésirable revenant chevauchant tous les égarements
Qui beugle sur leur carrousel les dissonants virements.
Tout un paysage!
\- Un petit bonheur est perché là-haut sur un gros matelas décousu,
Berceau débordant de fleurs et de sourires
Où le visage s’enfonce et n’entend plus,
Masque de draps frais qui s’applique à couvrir
Les promesses de punaises sans avenir
Et les déceptions d’hommes sans cesse à venir.
Lombrics
Les lombrics sortent de terre
Après que les nuages se soient secoués;
Les oiseaux ne font pas de manières
Et tirent sur les cimes nouées
Dans le vaste ciel de lierre.
Journée de dépense
Au matin on arrache des plantes pour fouetter le sol,
Et le haut sapin vert sert de toboggan.
La laborieuse machine à raisonnement,
Aux rouages tordus et grinçants,
Entame une marche, le temps d’une besogne
Puis tout retourne vite à ce beau fouillis;
Parades de fer aux déserts de bras,
Modeleurs de brouillons et cetera;
Cour autour des yeux d’enfants le souffle plein!
Ouvre le champ en un gouffre sans fond!
– Je plongeai la rose dans le vase.
Dépense coûteuse si l’on en croit le corps.
La nuit venue, la contrepartie pernicieuse se fait sentir.
L’enveloppe se fait molle,
La conscience primitive de la chaire effrayante;
Seule vérité peuplant le sommeil contrefait.
Encore les larsens du silence
Délivrent quelques enchantements;
Hallucine sur le cœur, des chants d’oiseaux printaniers
Assurément hors de propos.
Une enfance
I – IDENTITÉ
L’enfance a ses éclairs, oubliés,
Qui se retrouvent parfois, familiers,
Dans le reflet d’un toit en ardoise,
Un petit trou de bête sournoise,
Ou une mauvaise herbe dans un talus.
Une identité vague et voulue
Sur ces instantanés s’est bâtie,
Sous les têtes d’hortensias verdies
D’une vieille rue aux pavés ombragés
Ne voyant plus guère quelqu’un passer.
II – L’AUTRE
Deux enfants se regardent les yeux grands ouverts
Et se trouvent étranges. Ils se balancent en suivant,
Le mouvement de girouette des feuilles étourdissant,
Et tombent en deuil, sur le sable dur et sévère.
Leur regard est une ligne morte et figée,
Lointain souvenir d’une caresse pressée,
Faite le bras tendu, comme déjà partie,
De grosses larmes chaudes sur la gorge, à jamais serties.
III – LA FIN
Ce n’est pas tout à fait un bloc de pierres
Mais une fillette aux yeux cernés de charbon
Dans le fond du couloir d’entrée d’une maison,
Immobile, face au silencieux bord de mer,
Dernier souffle sous tout ce qui a vaincu,
Souvenir des îlots diaprés parcouru,
Étouffé par la seule présence d’un vent tendre,
Seule mélodie qu’on peut à présent entendre.
Jeux de couchant
Une ombre d’arbre tordue
Prend un volume dans la fumée d’un feu
Entre un regard et un soleil.
Le regard derrière deux sapins ronds
Se balance et se cache
D’une ombre à l’autre
Avec chaque fois le même plaisir
De se retrouver un instant
Au centre du triangle de lumière
Qui ouvre une voie
Sur les vertes mousses bombées
Gorgées du soupir du soir venant
Sur le point d’être relâché.
Œil de sable
Ses yeux sont un désert,
Surmonté d’un ciel uni,
Où l’on marche à l’envers,
Sans y être englouti.
Attirés vers son centre,
Nous sommes le reflet d’un songe,
Où l’on rentre,
Et s’allonge,
Se laissant alors prendre,
Par le feu qui nous ronge.
Couché
L’éternité abandonnée sur tout moment;
Sur un mégot d’ascenseur
Lâché, insignifiant acteur,
Par une main négligente sûrement,
Sur un homme endormi en posture indécente
Dans le dernier métro de nuit en attente;
Impossible à réveiller ni déloger,
S’étant fait pareillement déchargé,
Par une tête oisive et sans honte.
Éboueur errant, je ramasse à bon compte
Tout ce qui traine, de ma pelle de gourmand.
L’escalator ouvre le vif firmament,
Les rues peuplées d’ondes et de fibres,
Trébuchant sur les platanes ivres
En un bruit de vin ruisselant; qui détale!
Des roulements de feuilles sales
Escortent mes pas survolant le bitume
Sans détours ni choix vers mon lit d’infortune
Où je déposerai à mon tour indolent
Ainsi que ma lyre suite aux âpres chants
\- L’éternité,
Pour une durée.
Fougère
Sur le talus bordant le bois
Les Fougères se déploient,
Comme une langue de feu
Dégoulinant d’or crasseux.
Château
Perché sur la vieille et haute cheminée,
Le souffle du vent m’envoie vaciller.
Saisit sous ses caresses ennemies,
Je défis l’œil pâle et doré de la nuit,
Brillant sur les confins du monde,
Et les proches étangs, que je surplombe.
Dieu
Sous la longue robe du créateur à côté de la lampe, je contemplais les appareils de la justice, pendant de tout leur poids; faisant oublier aux hommes ce mollet et ce pied pourtant si bien dessiné, en répandant d’enivrants parfums. Les hommes, sous la lampe, tendent un miroir et font remonter leur image vers le ciel tapissé de peau et de poils, pour remercier et montrer qu’ils se sont bien imprégnés des divines sucreries. Mais le créateur pas plus qu’un autre, ne regarde sous sa robe.
– Un jour je suis parti plein de résolutions, loin de dessous la lampe, chercher les bougies de l’esprit pour leur souffler dessus; mais je n’ai trouvé que des brasiers immenses. Égaré et loin de tous les airs, de tous les égos et autres unités pesantes, je continuais, dos à la lampe, suivant ses rayons comme des fils d’Ariane. Ils s’affinaient vers les objets les moins éclairés, que je saisi à l’aveugle pour les ramener à la lumière. Je pouvais voir les monstruosités inachevées et informes qui servent de tissus hermétiques aux mondes! Je les tendis désespérément vers la source de lumière. Moi aussi je voulais encore montrer; mais les chimères délaissées au lieu des vertus à se damner! Non elle ne voit rien évidemment! Elle permet de voir seulement et voyez ce qu’elle me révèle à présent : elle enfante et prodigue, comme tous les morceaux d’espace qui, décidant un jour de fermer leur œil, se mettront à briller.
Réaction
Plus d’argent contre l’ennui!
Plus de gravure pour embellir les murs !
Plus d’artifices ou j’ouvre et claque des mâchoires de chiens !
– Je m’allonge dans un petit carré d’herbe graminée pour me poignarder, et jouis de ma posture comme si j’allais en mourir. Dans la ville tout est absorbé dans son image, des hommes sévères dans leurs voitures équipées d’orchestres aux mannequins bouffons des boutiques. On oublierait presque ceux qu’on ne voit pas dans leur cube lumineux, rêvant tous un autre, jouissant ou mourant. Toutes les semaines je reviens ici me mettre à genou sur le pavé devant un ticket déchiré, pour la sensation des fêtes aux teneurs de passé. Démon, je piétine en rond et ricane sur l’enfer des choses, derrière une vitre de chaire. Tout est de l’autre côté, qu’il y reste!
Charlotte
J’ai une bonne anecdote, sur ma copine charlotte,
Figurez-vous qu’un bon gros loup autour du cou,
Elle fit un voyage à vous tordre les genoux.
Bien qu’elle fût très encombrée elle n’était pas sotte,
Accoutrée comme ceci, elle attira les yeux,
Des passants bien accoutrés mais forts malheureux,
Leur offrant un spectacle drôlement paradé,
Qui une fois sous leur nez leur fit se demander :
« Mais que fait-elle ainsi? Souhaite-t-elle nous faire vomir?
Ce loup sent vraiment fort, nous ferions bien de fuir. »
Enfin elle se retrouva seule dans cette grande ville,
Où elle voulait déguster son loup, bien tranquille.
Ce qui ne peut guérir
Un corps envolé,
Un bonheur fané,
Il veut se trouver des raisons,
Mais se cache sous d’amères passions.
Ôde badine à la poche
Ô merveilleuse poche!
Plus pratique que toutes les sacoches ;
D’origine, sur pantalons et blousons tu t’accroches.
Grâce à toi, de la main les objets restent proches,
Que ce soit métaux précieux ou roche.
Ô vagabonde poche!
Si l’on peut te faire seulement quelques reproches,
C’est si un beau jour, usée tu t’effiloches,
Dispersant les gains du travail qu’on empoche,
Et si tu te retrousses, montrant tes versants moches.
Ô indomptable poche!
Quand parfois une main étrangère s’approche,
Pour se glisser dans ta fine et pudique encoche,
Ton maître menace de distribuer des taloches;
Alors plus que jamais angélique poche,
Tu fais tinter mon âme comme une cloche!
La vieille dame qui disparaît
I
Je suis à la salle des repas, où rode le serpent. Cette fois la vieille dame a presque disparu jusqu’au fond des êtres. Le serpent la regarde et je regarde le serpent. Je crois qu’il l’a déjà mordu; car son corps est noircit par le poison en beaucoup d’endroits. Je pleure alors toutes les larmes possibles. Dans la pièce on se moque de moi; de ce qu’on croit être joué; on n’a jamais pu voir cela en moi ou on ne l’a pas remarqué.
– La vieille dame se tient debout sans un mot à côté de moi, puis s’efface dans un dernier rêve.
II
Le dernier rêve est arrivé. Ressuscitée pour une dernière fois, la vieille dame est endormie. Elle est inconsciente dans son lit mais son cœur bat encore faiblement. Je le détiens dans un petit écrin précieux et le lui amène bientôt, dans une mission funèbre et forcée. Je me fraye un chemin à l’aide de mon doigt, à travers les buissons d’entrailles étouffant son cœur, et tente difficilement de déceler du regard ses légers soubresauts.
– Mon voyage ne trouve pas sa conclusion; et j’espère qu’il n’en veuille plus.
III
La vieille dame est bien morte, mais revient parfois
Aux plus importants et copieux repas,
Donnant quelques judicieux conseils, comme autrefois,
Dont malheureusement on ne se souvient pas.
Chapeau
Et porter un chapeau à la faculté! Une fixation sans relâche sur comment cet objet modifie leur image pour autrui, autrement dit un signe de masochisme. Et ça subit dans sa chaire les moindres coups de fouets et caresses des regards mais même ces caresses sont cruelles, car encore un doute. Une raison supplémentaire se donne pour alimenter l’angoisse, un espoir toujours là mais jamais satisfait d’une reconnaissance totale, absurde; intellect foutu de tous les idéaux misérables où regarde l’œil de la mort!
– Voilà des riens qui donnent malgré tout d’arbitraires choses, qui viennent comme une crotte d’oiseau tombée du ciel! Pour elles ils ont bien voulu se tenir là à attendre, et on peut y compter il y a toujours quelques choses qui tombent; tristes consolations et opium succinct; Ils ne font pas les délicats, peu importe si ça sent la merde. Qu’est-ce là pour moi sinon le symptôme de mon plus grand mépris, d’un orgueil souffrant qui jette un regard condescendant du haut de son malheur où il doit encore combattre ce qu’il reste de chapeau en lui?
Les mots s’arretent
Dans les mots où je dors,
Des reflets d’images me dévorent.
Dans l’oubli je m’apprête
Laissant intacte la salle secrète,
Le repas y est servi mais je n’y prends pas part,
Car je suis attendu à d’autre et déjà en retard.
Contemplation maximale chez la nourice
Les petits disciples de la nourrice occupée, sont assis autour de la table de la cuisine sous le néon circulaire glacé, auréole de leur ennui. Guidée par les soupirs chantonnés, sur un plateau l’encre coule jusque dans un coin réveiller le vieux pommier; il draine l’encre et bleuit comme un début de nuit, révélant ses chétives fleurs blanches. L’écureuil alors, voyant cette voûte se dessiner, rentre dans son trou dormir et rêver à ses tendres noisettes, sous la nappe si soigneusement entreposée.
– Le petit disciple ayant finit ses devoirs amène sa soupe sur le plateau, la renverse et emporte tout dans un torrent jaune crépitant.
L’agitation sort le disciple dressé au bout de la table de ses souvenirs, ne s’étant trouvé comme objet passé qu’un torse bombé ou une commode peinte avec un arc-en-ciel. Un autre se lève pour se diriger vers la fenêtre, et projette son visage au dehors. Le froid se dépose alors sur lui comme un linceul de lucidité écarquillant ses yeux sur les étourneaux, qui après une énième concertation sur la migration, éclatent des arbres laissés étourdis, dans une nuée de points noirs soulevant le ciel. La mère arrive; interrompt le recueillement, et rassemble les disciples dispersés. Ils voudraient raconter les jolies choses apprises, mais ne sortent de leur bouche que des piaillements.
Spectre du printemps
Le spectre luit
Si l’on inspecte en lui
Les dentelles d’araignée
Par la rosée s’arrachées;
S’il danse sur la pointe des flammes
Contemplé par les yeux de nuit calme.
– Tout est éteint sur le vert nouveau;
Son souvenir encore chaud
Court lentement sur les peaux.
Bonne nuit
Qu’un lourd croissant de lune s’agenouille sur tes yeux,
Dissipant d’un battement sourd les vents pernicieux.